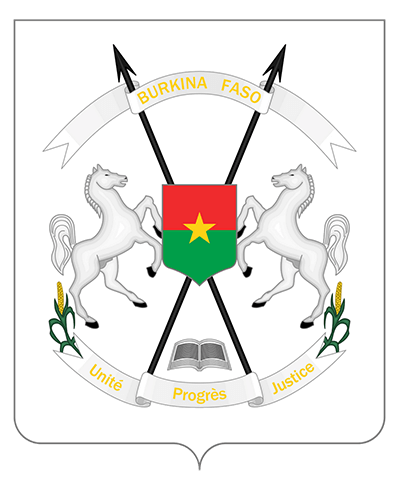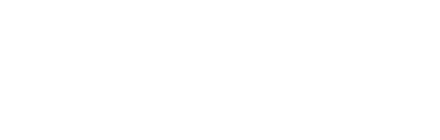Le service de la dette publique désigne le montant des sommes dues par l’Etat et ses démembrements aux créanciers pour honorer les engagements financiers nés des accords de prêts intérieurs ou extérieurs conclus. Il se compose généralement de deux éléments : le principal (capital dû) et les charges (intérêts, commissions d’engagement, commissions de services, pénalités, etc.).
Le règlement su service de la dette se fait en procédure simplifiée. Depuis 2017, conformément aux nouvelles directives de l’UEMOA le remboursement du capital constitue une opération de trésorerie et le paiement des intérêts une opération budgétaire.
Au niveau du Trésor Public, trois (03) structures se partagent à des degrés divers les prérogatives dévolues en matière de règlement du service de la dette publique :
- la Direction de la Dette Publique (DDP) qui est chargé:
- de l’élaboration du budget prévisionnel du service de la dette ;
- des relances et de la réception des avis d’échéances des bailleurs ;
- de l’initiation des lettres de transfert du capital et des intérêts à l’attention de la Trésorerie Générale de l’Etat (TGE) ;
- de la régularisation dans le Circuit Intégré de la Dépense (CID) des charges de la dette après réception des demandes de régularisation de la Trésorerie Ministérielle. Il s’agit de l’engagement par l’édition de « bons d’engagement ». Ces bons d’engagement accompagnés de pièces sont transmis électroniquement et physiquement à la Direction Générale du Contrôle et des Engagements Financiers (DGCMEF) du Ministère en charge des finances pour liquidation. Apres le visa de la DGCMEF, les bons d’engagement et les pièces sont ramenés à la DDP (transmission physique et électronique) pour la phase d’ordonnancement par l’édition des mandats. Les mandats signés par DDP sont transmis à la Trésorerie Ministérielle du Ministère en charge des finances pour prise en charge électronique.
- la Trésorerie Générale de l’Etat (TGE) qui est chargé :
- du règlement du capital et des intérêts de la dette ;
- de la comptabilisation du capital remboursé ;
- du transfert des charges de la dette à la Trésorerie Ministérielle du Ministère en charge des finances.
- la Trésorerie Ministérielle du Ministère en charge des finances qui est chargé de :
- la réception des charges de la dette transférées par TGE,
- l’initiation des demandes de régularisation à adresser à la DDP ;
- la comptabilisation des charges de la dette.
La gestion efficace de la dette consiste pour l’Etat à établir des stratégies qui lui permettent d’une part, de mobiliser les concours financiers requis pour satisfaire ses besoins de financement ainsi que ceux de ses démembrements et d’autre part, d’honorer ses obligations de paiements à moindre coût et risque possibles. La multiplicité des chantiers de développement économique et social et la modicité des ressources financières ont conduit l’Etat à offrir à ses démembrements, des garanties en matière d’endettement. Ces garanties revêtent deux (02) formes : la rétrocession et l’aval.
- La rétrocession
Elle consiste en la mobilisation par l’Etat, de ressources financières sous forme d’emprunt, don, subvention ou souscription publique, puis à leur mise à la disposition sous forme de prêt, à une personne morale éligible aux termes de la réglementation sur la rétrocession. Au Burkina Faso, la rétrocession est régie par le décret N°2009-150/PRES/PM/MEF du 27 mars 2009 portant réglementation générale de l’endettement public et de gestion de la dette
Publique. Ce décret définit en son chapitre 3 les personnes pouvant bénéficier de la rétrocession, les conditions et les procédures de rétrocession. Les bénéficiaires sont les sociétés à capitaux publics, les collectivités territoriales, les établissements publics de l’Etat et les personnes morales interétatiques de droit public dont l’Etat est membre ou actionnaire et les personnes morales de droit privé burkinabè reconnues d’utilité publique ou investies d’une mission de service public. Les ressources mobilisées et rétrocédées devraient concourir à la réalisation d’une opération d’investissement ou d’équipement conformément aux orientations du plan ou de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
- L’octroi de l’aval
L’aval est l’acte par lequel une autorité ayant la capacité d’engager l’Etat se porte garant auprès d’un bailleur de fonds du paiement régulier des échéances. C’est donc une garantie de paiement offerte par l’Etat au bailleur de fonds afin qu’il veuille accorder un prêt à une personne morale qui sollicite un financement destiné à un projet d’investissement ou d’équipement. Les conditions d’octroi de l’aval de l’Etat sont régies par le décret n° 2009-150/PRES/PM/MEF du 27 mars 2019 portant réglementation générale de l’endettement public et de la gestion de la dette publique. Ce décret définit en son chapitre 4 les modalités de gestion des avals de l’Etat. L’Etat accorde son aval sous certaines conditions et dans les limites du plafond fixé chaque année par la loi de finances, aux emprunts contractés par les sociétés à capitaux publics, les établissements publics de l’Etat, aux collectivités territoriales, les personnes morales interétatiques de droit public dont l’Etat est membre ou actionnaire et les personnes morales de droit privé burkinabè reconnues d’utilité publique ou investies d’une mission de service public. Les prêts éligibles à l’octroi de l’aval de l’Etat doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
la durée et le taux d’intérêt sont ceux des emprunts directs négociables par l’Etat sauf cas exceptionnels après avis spécifique du CNDP
la durée du différé d’amortissement est suffisante pour permettre la réalisation de l’investissement ou pour permettre le dégagement d’une marge brute de financement.
Le Burkina Faso fait régulièrement recours aux ressources d’emprunt pour le financement de son économie. Le bénéfice des ressources se fait soit par le marché financier régional soit par la mobilisation des appuis budgétaires ou la mobilisation des financements sous forme de prêts projets. En ce qui concerne les ressources d’emprunt local, une émission d’emprunt d’Etat dénommée « Soutien à la production » a été réalisée pour la première fois en 1996. Cette opération avait pour objectif la mobilisation de l’épargne nationale en vue du financement des secteurs de production notamment le secteur rural, le secteur informel, l’artisanat et les activités rémunératrices des femmes. Ce qui devait permettre la résorption des difficultés d’accès au financement bancaire que rencontrent ces secteurs. Le succès rencontré par cette opération, a convaincu l’ensemble des acteurs sur la possibilité de recourir au marché financier pour la collecte de l’épargne en vue de réaliser des projets d’investissements. Depuis lors le Burkina Faso, à travers le Trésor Public, a procédé à plusieurs émissions d’emprunts obligataires sur le marché financier de l’UEMOA. Conformément aux dispositions réglementaires, ces opérations font l’objet de large diffusion dans le public. L’appui ou aide budgétaire ou appui programme est une forme d’aide consentie par certains partenaires au développement et consistant à mettre à la disposition du budget d’un État des ressources non ciblées sur la base d’un cadre fédérateur des initiatives de développement du pays bénéficiaire. L’aide budgétaire permet à un État d’effectuer les dépenses inscrites dans la Loi de Finance selon les procédures nationales. Elle se différencie en cela de l’aide projet qui utilise des procédures spécifiques pour financer des actions clairement identifiées.
Les principaux partenaires multilatéraux et bilatéraux du Burkina Faso
Plusieurs bailleurs de fonds interviennent ainsi au Burkina Faso soit à travers le financement des projets soit à travers le financement des programmes par des apports en dons ou prêts. Au titre des partenaires multilatéraux on compte : le Fonds Européen de Développement de l’Union Européenne (FED/UE), la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), Banque Islamique de Développement (BID), le Fonds de l’OPEP pour le Développement International (OFID), le Système des Nations Unies, la Banque Africaine Développement (BAD), le Fonds International de Développement Agricole (FIDA), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), l’Association Internationale de Développement (IDA), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO, le Fonds de Développement Nordic, le Fonds Monétaire International (FMI). Au titre des partenaires bilatéraux on peut citer : l’Allemagne, la France, le Fonds Saoudien de Développement (FSD), le Fonds Koweitien pour le Développement Économique en Afrique (FKDEA), les Pays-Bas, le Japon, l’Autriche, le Fonds Abû Dabhi, le Danemark, l’Inde, la Suède, la Suisse, le Taiwan, la Nordea Bank. Les pays donateurs disposent pour la plupart d’organes et des structures de coopération qui participent à la mise en œuvre de la coopération au développement.
- L’analyse de la viabilité de la dette (AVD)
- Faible : tous les indicateurs d’endettement sont nettement en dessous des seuils ;
- Modéré : les indicateurs d’endettement sont en dessous des seuils dans le scenario central, mais dépassent ces seuils en cas de chocs externes ou de changements abrupts dans les politiques macro-économiques ;
- Élevé : au moins un indicateur d’endettement dépasse les seuils dans le scenario central ;
- En difficulté/surendetté : le pays fait déjà face à des difficultés de paiement.
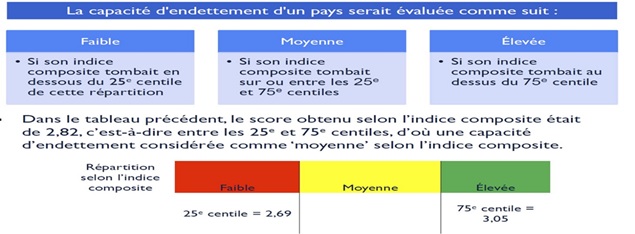 La comparaison entre les indicateurs d’endettement et les seuils dans le CVD donne des signaux sur le risque de surendettement. Ce risque peut s’apprécier aussi bien sur la dette extérieure que sur la dette publique totale
On détermine le signal du risque de surendettement public extérieur en comparant la trajectoire des indicateurs de la dette extérieure PPG à leurs seuils indicatifs pendant les dix premières années de la projection, dans le scénario de référence et des tests de résilience.
La comparaison entre les indicateurs d’endettement et les seuils dans le CVD donne des signaux sur le risque de surendettement. Ce risque peut s’apprécier aussi bien sur la dette extérieure que sur la dette publique totale
On détermine le signal du risque de surendettement public extérieur en comparant la trajectoire des indicateurs de la dette extérieure PPG à leurs seuils indicatifs pendant les dix premières années de la projection, dans le scénario de référence et des tests de résilience.
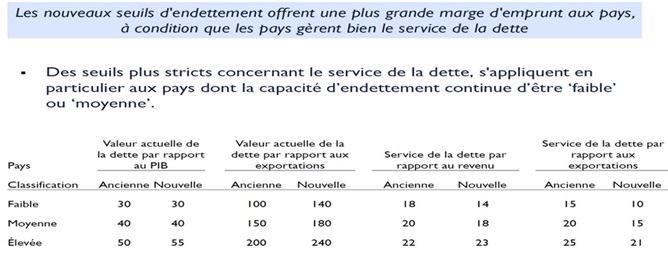 Le risque global de surendettement est estimé au moyen d’informations conjointes tirées des cinq Indicateurs d’endettement : les quatre de la composante « dette extérieure » comparés à leurs seuils indicatifs, et le ratio de la VA de la dette publique au PIB qui est comparé à son point de référence indicatif.
2. La Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT)
La SDMT est un plan de l’Etat pour répondre à ses besoins de financement et parvenir à une composition souhaitée du portefeuille de la dette publique à moyen terme. Elle contient une série de mesures et d’orientations permettant d’assurer le respect des indicateurs d’endettement à moyen terme.
La SDMT fournit une orientation pour la gestion de la dette publique sur une période triennale après analyse des risques liés au portefeuille. Elle vise aussi à assurer une meilleure gestion de la dette publique permettant de pourvoir aux besoins de financement de l’Etat et à ses obligations de paiement au moindre coût possible à long terme, tout en maintenant les risques à un niveau satisfaisant.
En août 2019, la cellule technique du CNDP a élaboré une nouvelle SDMT 2020-2022 avec un plan de financement 2020 pour le Burkina Faso. Elle a été validée et annexée au projet de loi de finances, gestion 2020.
De façon spécifique, cette nouvelle stratégie a pour objectif d’améliorer le marché de la dette intérieure par le renforcement et le développement des marchés locaux efficaces de la dette primaire et secondaire pour les titres publics, en réduisant progressivement la dépendance à l’égard des sources étrangères et en accroissant la transparence du marché.
En termes de perspective, elle prévoit également (i) le Maintien du recours aux ressources concessionnelles pour le financement des besoins de l’économie et (ii) le recours aux ressources extérieures non concessionnelles en conformité avec le programme de Facilité Elargie de Crédit (FEC) du Fonds Monétaire International (FMI).
Le risque global de surendettement est estimé au moyen d’informations conjointes tirées des cinq Indicateurs d’endettement : les quatre de la composante « dette extérieure » comparés à leurs seuils indicatifs, et le ratio de la VA de la dette publique au PIB qui est comparé à son point de référence indicatif.
2. La Stratégie de gestion de la Dette à Moyen Terme (SDMT)
La SDMT est un plan de l’Etat pour répondre à ses besoins de financement et parvenir à une composition souhaitée du portefeuille de la dette publique à moyen terme. Elle contient une série de mesures et d’orientations permettant d’assurer le respect des indicateurs d’endettement à moyen terme.
La SDMT fournit une orientation pour la gestion de la dette publique sur une période triennale après analyse des risques liés au portefeuille. Elle vise aussi à assurer une meilleure gestion de la dette publique permettant de pourvoir aux besoins de financement de l’Etat et à ses obligations de paiement au moindre coût possible à long terme, tout en maintenant les risques à un niveau satisfaisant.
En août 2019, la cellule technique du CNDP a élaboré une nouvelle SDMT 2020-2022 avec un plan de financement 2020 pour le Burkina Faso. Elle a été validée et annexée au projet de loi de finances, gestion 2020.
De façon spécifique, cette nouvelle stratégie a pour objectif d’améliorer le marché de la dette intérieure par le renforcement et le développement des marchés locaux efficaces de la dette primaire et secondaire pour les titres publics, en réduisant progressivement la dépendance à l’égard des sources étrangères et en accroissant la transparence du marché.
En termes de perspective, elle prévoit également (i) le Maintien du recours aux ressources concessionnelles pour le financement des besoins de l’économie et (ii) le recours aux ressources extérieures non concessionnelles en conformité avec le programme de Facilité Elargie de Crédit (FEC) du Fonds Monétaire International (FMI).